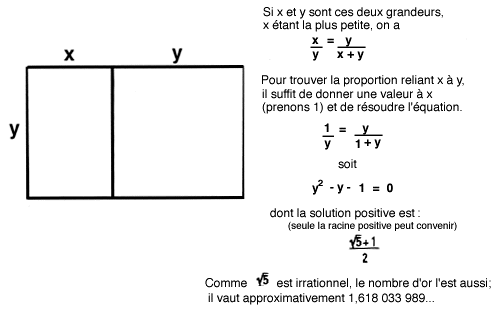" Il est trois sorte de perspectives : la première relative aux
causes de la diminution, ou, comme on l'appelle, à ma perspectives
diminutive des objets à mesure qu'ils s'éloignent de l'œil.
La seconde est la manière dont les couleurs se modifient en s'éloignant
de l'œil. La troisième et la dernière consiste à
définir comment les objets doivent être achevés avec d'autant
moins de minutie qu'ils sont plus éloignés( le
sfumato).
Et leurs noms sont :
-perspective linéaire ;
-perspective de la couleur ;
-perspective de la diminution. "
Carnets de Léonard de Vinci

Dans la composition du retable de grand format, Léonard a repris en
grande partie les représentations conventionnelles du 15e siècle
: l'archange Gabriel est agenouillé dans le jardin de la Vierge ( Jacques
apocryphe 11, Luc 1 : 26 - 38
), qui, assise au pupitre apprend qu'elle a été choisie pour
mettre au monde le fils de Dieu.
La scène est flanquée à droite d'un édifice contemporain,
un mur à mi-hauteur délimitant le centre est interrompu par
un petit passage. Cette ouverture, qui sert de fond au geste de salut de Gabriel
et au lys dans sa main gauche, permet de voir un sentier se perdant dans
la profondeur du tableau. La silhouette d'une petite forêt et les montagnes
à l'horizon se découpent nettement sur le ciel lumineux, formant
ainsi l'arrière-plan du tableau.
La robe de l'ange, coupée par le bord gauche du tableau, suggère
une continuité entre l'espace peint et l'espace réel.
Il subdivise l'espace pictural en autant de parties égales, créant
ainsi un schéma à l'intérieur duquel il dispose les différents
éléments du tableau.
Cette scène est organisée de manière régulière,
les zones vides créées par les paysages alternant avec les zones
occupées par les personnages. Les mouvements ont le rythme d'une phrase
musicale : au geste de l'ange qui lève le bras en signe de bénédiction,
correspond celui de la Vierge qui, surprise, lève la main en reculant.
Léonard a organisé la scène à l'intérieur
d'une structure de formes géométriques. Ce sont les éléments
mêmes du tableau qui nous guident dans la lecture de ce schéma.
Les cyprès, répartis à égale distance les uns
des autres, divisent la surface en cinq rectangles égaux ; les personnages,
inscrits dans des triangles, occupent respectivement le premier et les deux
derniers rectangles, créant à leur tour une succession de cinq
triangles.
Le nombre d'or
Depuis l'Antiquité, les géomètres et les philosophes
ont cru à l'existence d'une proportion privilégiée que
les artistes de la Renaissance appelèrent le « Nombre d'or ».
Une harmonie, que certains estiment parfaite, existe entre deux grandeurs,
notamment entre deux dimensions, lorsque celles-ci sont entre elles dans la
même proportion que la plus grande avec leur somme.